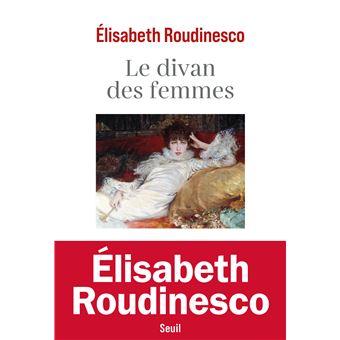Soutenez l'Appel des Appels
- De quoi la « dé-civilisation » est-elle le nom ? Un éloge réparateur et humaniste de la création envisagée en tant que lutte sociale et politique pour l’émancipation des êtres humains.
- Dans nos sociétés de contrôle, l’information est le moyen privilégié de surveiller, de normaliser et de donner des ordres. Les informations, molécules de la vie sociale, deviennent les sujets de...
- Il fallait à notre pays un certain culot pour élire à la magistrature suprême un jeune homme quasiment inconnu, négociateur habile du compromis autant que «traître» méthodique. Emmanuel Macron...
- Dans le clair-obscur des crises politiques naissent les monstres. Ils naissent du vide culturel d’un monde politique sans esprit, d’un monde où les techniques sont devenues folles, d’un monde qui...
Le nouveau malaise français
Alors que le médiateur de la République s'alarme de la « fatigue psychique » des Français, le sociologue publie « la Société du malaise ». Il débat avec l'initiateur de l'Appel des Appels
Le Nouvel Observateur/France-Culture.Jean-Paul Delevoye, le médiateur de la République, vient de rendre son rapport annuel où il souligne que « la société française est fatiguée psychiquement ». Il s'inquiète d'une «société qui se fragmente, où le chacun pour soi remplace l'envie de vivre ensemble ». Que vous inspire ce « diagnostic » ?
Roland Gori. - La notion de fatigue psychique est certes floue mais ce rapport reflète assez bien l'état actuel de l'opinion. Le médiateur de la République parle d'une inquiétude que nous avons constatée lors des différentes journées de l'Appel des Appels [qui a récemment regroupé un grand nombre d'intellectuels et de professionnels de la santé mentale, de l'éducation et de la justice « contre les conséquences sociales désastreuses des réformes mises en place par Nicolas Sarkozy », NDLR]. Ces professionnels ont témoigné de leur crainte de voir leurs métiers respectifs décomposer et recomposer selon les « valeurs » du néolibéralisme qui ont fait la preuve de leur toxicité. Le rapport du médiateur décrit l'état de l'opinion, mais n'explique pas les causes pour lesquelles nous en sommes là - et en particulier les réformes que nous subissons. Par ailleurs, la globalisation s'accompagne d'une fragmentation, non seulement entre les pays, mais aussi à l'intérieur de chaque Etat en aggravant les inégalités sociales. La notion de fatigue psychique pose de nombreux problèmes. Elle peut être une façon de parler de la souffrance sociale en la déguisant sous des termes psychologisants. Mais la « souffrance psychique » est aussi un concept précis de la psychopathologie qui rend compte du conflit psychique et de ses symptômes. Si on ne définit pas précisément cette notion, elle devient un fourre-tout, une façon de dire qu'aujourd'hui il y a un malaise social que supportent les sujets singuliers et collectifs dans leur rapport à la société.
Alain Ehrenberg. Le rapport Delevoye est dans le ton d'aujourd'hui : nos relations sociales se formulent désormais dans un langage des affects qui distribue entre le « bien » de l'épanouissement personnel et le « mal » de la souffrance psychique. La question est alors : comment parler de ce souci social et politique récent et selon quels critères ? Dans « la Société du malaise », je suis parti des questions que se posent les professionnels de la santé mentale : les symptômes ont-ils changé ? Les personnalités se sont-elles modifiées ? Comment les normes et les valeurs sociales jouent-elles ? Ma réponse est qu'à de nouvelles manières d'agir en société, rassemblées par le concept d'autonomie, correspondent des nouvelles manières de subir, qui se condensent dans la notion de souffrance psychique. Les questions de santé mentale sont au centre des préoccupations de toutes les sociétés développées mais, chez nous, elles sont pensées en termes de malaise dans la société, dans la civilisation, etc. C'est pourquoi je parle de société du malaise. Le malaise se résume dans une double idée : le lien social s'affaiblit, ce que les sociologues appellent la « désinstitutionalisation», et, en échange, l'individu est surchargé de responsabilités et d'épreuves qu'il ne connaissait pas auparavant, c'est la « psychologisation ». Cette opposition entre personnalité et institution me semble caractériser le cas français. De cette opposition on tire des conclusions abstraites mettant en cause la modernité, la postmodernité, le capitalisme globalisé, le nouvel individualisme, etc. Bref, on est dans le slogan. L'idée que la société engendre des souffrances psychiques est une idée sociale, elle n'est pas une explication sociologique. La sociologie doit l'élaborer, par exemple en décrivant comment des sociétés différentes conçoivent les rapports entre malheur personnel et relations sociales troublées. J'ai donc étudié comment en France et aux Etats-Unis - qui présentent des contrastes forts dans leurs conceptions de l'égalité et de la liberté -, des affections individuelles sont devenues des affections sociales, c'est-à-dire qui trouvent leur raison d'être dans les désordres du groupe, ceux de la famille, de l'entreprise, de la société en général... Je suis parti de l'idée commune que les gens souffraient auparavant de névroses de transfert, de névroses oedipiennes, mettant en forme un conflit entre le permis et le défendu, caractéristique d'une société d'interdits et de répression ; et qu'aujourd'hui ils souffrent de pathologies narcissiques et d'états limites, qui font partie de ce que les psychanalystes appellent les «névroses de caractère » mettant en cause la personnalité, où ce sont plutôt des angoisses de perte que de conflit qui sont en jeu. De là, j'ai décrit comment ont été élaborés les rapports entre symptôme, personnalité et transformation des normes sociales. J'ai ainsi comparé deux individualismes, deux manières de faire société, mais aussi deux psychanalyses. Il est frappant de constater à quel point le concept de personnalité occupe là-bas la place que le concept d'institution occupe chez nous.
N. O./F.-C. - Roland Gori, vous affirmez dans la charte de l'Appel des Appels qu'il faut «faire face à la souffrance sociale que génèrent le marché et une société du mépris ».
R. Gori. - A partir du moment où aujourd'hui, en France, 50% des personnes pensent qu'elles risquent de se retrouver un jour SDF, quelque chose de grave s'est produit dans nos sociétés de normalisation avec un accroissement infini des exigences imposées aux individus sans même l'espoir d'un avenir de progrès social. Quand vous constatez que près de 80% de Français pensent que l'avenir de leurs enfants sera pire que le leur, cela veut dire qu'on ne croit plus au progrès. Lors des journées de l'Appel des Appels, nous avons eu le témoignage indiscutable que cette souffrance sociale existait aussi chez les professionnels, qui ont le sentiment que leurs professions sont instrumentalisées dans le sens du contrôle social et qu'elles perdent leur substance éthique.
Avec la notion de « fatigue psychique » s'ajoutant à celle de « souffrance psychique », nous franchissons une étape supplémentaire dans la médicalisation de l'existence. Y a-t-il pour autant un accroissement de la souffrance psychique ? Tout dépend du sens que l'on donne à cette expression. Là, je me méfie d'une psychologisation du social. On confond trop souvent la manière dont les symptômes se manifestent avec ce qui les produit. Par exemple, à propos de ce qu'on appelle névrose du vide ou état limite, l'analyse sociologique peut montrer que ces formes d'expression des symptômes ont un rapport avec les valeurs de la culture, mais cette névrose du vide, pour certains psychanalystes, c'est l'hystérie au présent. Car l'hystérie varie avec l'air du temps. L'investissement du manque, les symptômes de la panne se produisaient autrefois au niveau corporel. Aujourd'hui, l'hystérie, sans disparaître pour autant du niveau corporel, peut se déplacer dans le registre des relations sociales. Ce qui change alors, c'est la manière d'exprimer le conflit psychique, de le diagnostiquer ou de le prendre en charge, mais pas forcément le conflit lui-même. Maintenant, si vous entendez par souffrance psychique le fourre-tout d'un malaise social et existentiel, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, la souffrance sociale est produite d'abord et avant tout par une financiarisation sans précédent de l'humain, financiarisation et chosification de toutes les activités humaines qu'un Jaurès annonçait dès 1888, dans «la Dépêche de Toulouse», avec un très beau texte qui s'appelle «Nous faisons un beau rêve », où il parle justement de cette corruption des consciences et de cet abaissement de la valeur du travail par l'usure et la finance. Nous sommes aujourd'hui dans une civilisation d'usuriers qui accroît la souffrance sociale.
A. Ehrenberg. - La souffrance sociale est une souffrance psychique d'origine sociale. La souffrance psychique est devenue un test de la qualité de nos relations sociales et une raison d'agir sur des relations sociales perturbées ou qui sont considérées comme telles. C'est à mon avis le point central. On a le sentiment que nous vivons dans des sociétés très spéciales qui engendrent cette souffrance par insuffisance de liens sociaux. En fait, on a assisté à un changement de statut social de la souffrance psychique et non à un affaiblissement du lien social. Dans ce changement, nous avons trouvé un langage de l'infortune associant le mal individuel au mal commun. C'est un traitement des passions, et l'on oublie sans doute la dimension passionnelle de la vie sociale dans ces discours de la dénonciation. Toute société possède de tels langages.
N. O./F.-C. - Alain Ehrenberg, vous montrez d'un côté que ce que vous appelez la «jérémiade américaine » aurait pris la place de l'individualisme civique américain traditionnel que les bureaucraties de l'Etat fédéral auraient déresponsabilisé. De l'autre, vous critiquez la « déclinologie » française. On dit en France souffrir de l'injonction à l'autonomie, de l'obligation nouvelle de s'affirmer et de prendre des initiatives, de ce que vous appelez l'« excès de responsabilité individuelle ».
A. Ehrenberg. - Je considère qu'on a là deux récits qui mettent en scène les dilemmes de deux sociétés, mais je les conteste comme sociologie car ils restent prisonniers d'une psychologie collective.
La signification sociale attribuée aux pathologies narcissiques dans les deux sociétés est fort différente. Dans le cas américain, elles apparaissent à la fin d'un cycle libéral qui va de Roosevelt à Johnson, et qui est caractérisé par une intervention forte de l'Etat fédéral. Elles sont conçues comme le symptôme d'un déclin de la responsabilité individuelle à l'aune d'un excès d'Etat et marquent la nostalgie d'une époque où régnaient l'individualisme rugueux et la communauté autogouvernée. Elles expriment une crise de confiance des Etats-Unis en eux-mêmes. En France, au contraire, elles apparaissent comme le signe d'un excès de responsabilité individuelle résultant du retrait de l'Etat. Du côté français, nous avons atteint les limites d'une égalité pensée principalement en termes de protection qui a abouti à une balkanisation de l'emploi et à protéger les plus protégés. Du côté américain, la culture des seules opportunités individuelles a également montré ses limites. De Reagan à Bush, cela a abouti à un accroissement démesuré des inégalités sociales, à un endettement faramineux des ménages qui a implosé dans la crise économique. Les Etats-Unis sont donc confrontés à la nécessité d'introduire de la protection dans un système qui marche à l'opportunité, et on en voit les difficultés avec les débats interminables sur l'assurance-maladie universelle. Mais leurs débats sont imprégnés de leurs mythologies nationales comme nos débats sont imprégnés des nôtres. La France est confrontée à la nécessité d'introduire une dose d'opportunité dans un système qui marche à la protection. Ces deux sociétés représentent deux pôles de l'individualisme.
N. O./F.-C.- Roland Gori, vous reconnaissez-vous dans cette opposition entre les deux modèles d'individualisme américain et français ?
R. Gori. - Il y a une part de vérité. Ce que l'on déplore en France, c'est le désengagement de l'Etat, la vente à la découpe des services publics, la privatisation galopante, la colonisation par une langue de la compétition, de la concurrence, de la réactivité immédiate. Bref, tout ce que nous avons l'habitude de dénoncer. Il est possible qu'il y ait des expressions régionales différentes entre les Etats-Unis et la France, mais aussi selon les milieux et les classes sociales au sein même de chacun de ces pays. Je ne suis pas convaincu par une opposition frontale entre les deux cultures. Partout dans le monde, il y a une grande diversité d'idiomes et de dialectes exprimant cette souffrance sociale. Mais aussi, comme en témoigne l'Appel des Appels, un grand espoir de reconstituer du collectif à partir des forces mêmes d'opposition à cette instrumentalisation de l'humain. Et aux Etats-Unis comme en France, nous sommes face à quelque chose qui est de l'ordre de l'idéologie, c'est-à-dire d'une injonction sociale accomplie au nom d'une description prétendument scientifique ou technique de la réalité. Cette idéologie imprègne les dispositifs de diagnostics et de soins psychiatriques. Dans le domaine de la santé mentale, il n'y a pas d'Immaculée Conception des savoirs et des pratiques. Les diagnostics psychopathologiques et psychiatriques ne sont pas des réalités naturelles, mais ce que j'appelle des « réalités transactionnelles ». Ces diagnostics se négocient sur le marché de la souffrance, selon les valeurs de la culture, les préjugés et le savoir des experts qui les fabriquent. Quand vous voyez par exemple qu'en France les diagnostics de la dépression ont été multipliés par sept de 1979 à 1997, ce n'est pas parce qu'on a affaire à sept fois plus de déprimés. Ce ne sont plus les mêmes praticiens qui diagnostiquent la dépression. Ce ne sont plus seulement les psychiatres, mais aussi les autres médecins. Le périmètre de la dépression s'est accru parce que les critères d'inclusion des patients dans la pathologie de la dépression ont changé et la formation des médecins avec. Si le livre d'Alain Ehrenberg me paraît intéressant, c'est parce qu'il montre que nous avons tendance à théoriser toujours davantage le malaise social dans un discours psychologique. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ça a au moins cinquante à soixante-dix ans. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui où l'«homo psychologicus » tend à être remplacé dans la nouvelle santé mentale par un « homme neuroéconomique » nous y gagnions au change. Ni du point de vue singulier, ni du point de vue collectif. Avec cet « homme neuroéconomique » qui pilote sa vie comme un jeu d'économie expérimentale, on risque de nous faire passer de la culture du tragique à la civilisation du cynisme.
Je ne suis pas sûr que la notion de « fatigue psychique » ait une très grande réalité psychologique, mais elle a au moins un mérite, celui de nous dire qu'aujourd'hui les gens ne se sentent pas bien, qu'ils vivent dans un monde d'incertitude en pleine expansion dans lequel ils ont de plus en plus de difficulté à écrire le récit de leur vie, à le rendre lisible pour eux-mêmes, pour les autres et pour leurs enfants.
A. Ehrenberg. - On peut certes pratiquer ce rituel d'exorcisme du mal présent au profit d'un passé idéalisé, mais cela nous laisse démunis quant à l'action à mener. On est là dans ce que Marx a appelé le drame des Français qui est celui des « grands souvenirs » et du « culte réactionnaire du passé ». Sur ces sujets, on s'adresse trop au coeur et pas assez à l'intelligence des gens.
En fait, nous avons aujourd'hui des problèmes tout à fait classiques d'inégalités sociales et d'injustice qui concernent toujours les mêmes populations - les classes populaires -, mais dans le contexte du travail flexible et de la mondialisation. Nous sommes dans une crise de l'égalité à la française parce que l'égalité d'aujourd'hui est plutôt une égalité de l'autonomie, dans laquelle il s'agit de rendre les individus capables de saisir des opportunités en les aidant à entrer dans la compétition et à s'y maintenir. La nature des nouvelles inégalités implique la responsabilité individuelle parce que, dans des économies de la connaissance, l'égalité des chances dépend de ses propres capacités relationnelles et cognitives. Je milite donc pour une politique de l'autonomie qui joue sur les capacités d'agir des personnes, et particulièrement de celles qui subissent le plus les inégalités sociales. Le concept de capacité, tel qu'il a été mis en avant par Amartya Sen mais aussi par des sociologues comme Esping-Andersen et Jacques Donzelot, permet de redéfinir la substance de la solidarité sociale dans un monde de mobilité et de concurrence généralisée. Il donne une large place à la responsabilité individuelle, ce qui est un thème de droite, mais, et c'est là une ressource pour la gauche, il implique la responsabilité collective en subordonnant l'idée de protection à celle d'égale distribution des moyens d'agir. Ces notions heurtent les principes français parce qu'elles semblent totalement opposées à notre idée de la solidarité. Pourtant, on a là le nouveau modèle au sein duquel les problèmes de justice, de lutte contre les inégalités, de solidarité, de rapports entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective s'élaborent. Le drame français est d'être une société a-libérale dans un monde devenu libéral. Mais nous ne sommes pas condamnés au culte réactionnaire du passé.
Gilles Anquetil, François Armanet; entretien publié dans le Nouvel Observateur
- FORUM EN VISIO DIFFUSION Un grand forum se prépare ! Organisé en visioconférence, il sera diffusé en direct par Lacan Web Télévision le 12 mars prochain à partir de 20h. La parole sera donnée à de nombreuses personnalités du champ psy...
- Albert Ciccone est professeur émérite de psychopathologie et psychologie clinique (université Lumière-Lyon 2), psychologue, psychanalyste, président de la Convergence des Psychologues en Lutte (CPL) et de l’Association Lyonnaise pour une Psychanalyse À partir...
- Alors que la presse générale n'a de cesse de concentrer ses analyses sur la question du nombre trop important de fonctionnaires ou l'efficacité du service public, à la faveur des échéances électorales, Christelle Mazza décrit, sans filtre, les...
- À paraître le 06/03/2026 Rencontre à la librairie Compagnie (Paris), à 20h, avec Elisabeth Roudonesco autour de son livre, Le Divan des femmes.
- A lire sur Mediapart. Après quatre mois de grève, le mouvement étudiant s’est transformé. Avant la rentrée universitaire de la mi-août, ses animateurs veulent mobiliser tout l'été. Et il est de plus en plus question d'élections anticipées...
- Par PIERRE JOLY Psychothérapeute à la Maison Saint-Jacques, Montréal Article paru dans Libération du 11 juin. Les étudiants québécois s’opposent au gouvernement libéral de Jean Charest qui a décrété une hausse de 75% (en cinq ans) des...
Le nouveau monde et la crise des valeurs. Manifeste de soutien aux étudiants et collègues québécois.
Pour les plus anciens d’entre nous, l’insurrection étudiante au Québec réveille de bien vieux souvenirs. Comparaison n’est pas raison. Il n’empêche.
Copyright © 2011 L'Appel des appels | Tous droits réservés - Contact